Chirurgie de la base du crâne
NeurochirurgieQue signifie une lésion dans la région de la base du crâne ?
La base du crâne comprend la partie inférieure du crâne et ses transitions avec la colonne cervicale, le nasopharynx et les os de la face. Une lésion située dans cette région affecte souvent les parties basses du cerveau (par exemple le tronc cérébral) et les 12 nerfs crâniens, de sorte qu'une atteinte de ces structures neuronales conduit souvent à la découverte de la lésion.
Une telle lésion peut être causée par une tumeur (méningiome de l'aile sphénoïdale, neurinome acoustique), par une blessure (fracture du crâne dans la base frontale du crâne), par l'instabilité des articulations crânio-cervicales ou par des maladies inflammatoires.
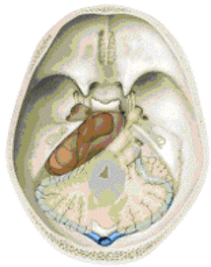
Figure 1 : Méningiome dans la base crânienne postérieure (marron). Le cervelet et le tronc cérébral peuvent être déplacés par la tumeur. Les tumeurs touchant l'os pétreux se développent également de la partie postérieure vers la fosse crânienne moyenne (ce que l'on appelle les "méningiomes pétroclivaux").
Image avec l'aimable autorisation du Prof. S. Rosahl, Erfurt
Si les nerfs crâniens sont touchés par une lésion, les symptômes suivants peuvent apparaître :
- Troubles de l'odorat et du goût (nerf olfactif)
- Troubles de la vue (nerf optique)
- Vision double (nerfs oculomoteurs)
- Douleur faciale ou engourdissement de certaines parties du visage (nerf trijumeau)
- Paralysie de certaines parties des muscles faciaux (nerf facial)
- Perte d'audition, acouphènes (nerf acoustique)
- Vertiges et instabilité (nerf vestibulaire)
- Troubles de la déglutition, enrouement (nerfs crâniens caudaux)
- Faiblesse des muscles du visage, de la tête et des épaules
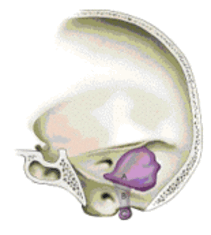
Figure 2 : Les tumeurs de la région des nerfs crâniens caudaux peuvent s'étendre à travers les canaux osseux de la base du crâne et le foramen magnum dans la région de la jonction crânio-cervicale.
Image avec l'aimable autorisation du Prof. S. Rosahl, Erfurt
D'autres symptômes, tels que l'instabilité, la paralysie et l'engourdissement de tout le corps, peuvent être déclenchés par une pression sur le tronc cérébral (voir figure 1). L'obstruction du liquide céphalo-rachidien (LCR) peut entraîner des troubles de la marche, des problèmes de mémoire, des maux de tête et un dysfonctionnement de la vessie. Si les lobes antérieurs ou temporaux du cerveau sont comprimés par une lésion de la base du crâne, des changements de personnalité et des crises d'épilepsie peuvent survenir. Des troubles hormonaux (pression sur l'hypophyse) sont parfois les signes d'une lésion de la base du crâne.
Quelle méthode d'examen peut révéler une maladie dans la région de la base du crâne ?
La plupart des lésions peuvent être détectées grâce à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et à la tomodensitométrie (TDM).
Les examens fonctionnels des nerfs crâniens, tels que les tests d'audition, de vision et d'équilibre, sont souvent utilisés. Des études électrophysiologiques (par exemple BAEP = potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral) complètent ces tests.
Pour les tumeurs vasculaires, une imagerie vasculaire (angiographie conventionnelle) est parfois nécessaire.
Quelles sont les options thérapeutiques ?
En l'absence de traitement, une perte de fonction permanente pouvant aller jusqu'à l'endommagement des centres vitaux du tronc cérébral peut se produire.
Pour traiter avec succès les maladies de la base du crâne, une bonne collaboration entre plusieurs experts dans des centres interdisciplinaires est généralement la meilleure solution. Dans notre équipe interdisciplinaire, neurochirurgiens, chirurgiens oromaxillofaciaux, spécialistes ORL, ophtalmologues, neuro-radiologues et radiothérapeutes travaillent ensemble. Pour les cas difficiles, le meilleur traitement est discuté lors d'une conférence sur la base du crâne.
Les lésions de la base du crâne doivent être traitées souvent très rapidement. Pour les tumeurs à croissance lente, cependant, il n'y a souvent pas de contrainte de temps directe. Des médicaments décongestionnants ou inhibiteurs de croissance sont parfois utilisés. Les processus très vascularisés se prêtent à un traitement par cathéter (embolisation). Dans certaines tumeurs, la radiothérapie et la radiochirurgie peuvent donner d'excellents résultats et sont souvent utilisées en complément de la chirurgie.
Une opération est indiquée si les autres traitements sont moins efficaces, s'ils entraînent des effets secondaires graves ou si le diagnostic est remis en question. Le but de l'opération est d'éliminer la cause de la maladie existante et de prévenir ou de retarder l'apparition de nouveaux symptômes.
Le choix de la méthode chirurgicale dépend de la nature et de la localisation du processus pathologique. L'approche chirurgicale doit être aussi minimale que possible. Les procédures microchirurgicales et endoscopiques sont particulièrement utilisées, parfois en combinaison. En fonction de la localisation de la maladie, des experts de différentes disciplines chirurgicales travaillent main dans la main.
La navigation peropératoire et la surveillance neurophysiologique (voir figure 3) peuvent faciliter la planification précise de l'intervention chirurgicale et l'opération elle-même. Sous le microscope opératoire, le chirurgien peut visualiser la lésion.
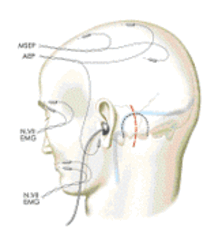
Les tumeurs peuvent être enlevées à l'aide de micro-instruments spéciaux, d'un aspirateur à ultrasons, d'une coagulation, d'un laser ou de canules d'aspiration. Les malformations vasculaires sont fermées à l'aide de clips en titane ou enveloppées de divers matériaux.
Figure 3 : Surveillance électrophysiologique de la fonction des nerfs crâniens pendant une intervention chirurgicale sous anesthésie générale.
Image avec l'aimable autorisation du Prof. S. Rosahl, Erfurt
Méthodes neurochirurgicales de traitement de la maladie de Graves (Morbus Basedow)
En raison de cette maladie initialement associée à la thyroïde, le tissu adipeux augmente dans l'orbite, sous l'effet des auto-anticorps. Il en résulte une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, parfois douloureuse, et un gonflement des yeux (exophtalmie). En outre, une déficience visuelle, des images diplopiques, des rougeurs et une sensibilité accrue de l'un ou des deux yeux peuvent survenir. Dans ces cas, une intervention chirurgicale - la décompression orbitaire - peut réduire la pression oculaire. Les bords de l'os orbital sont partiellement enlevés par une petite incision de la tempe afin de donner plus d'espace au tissu adipeux. Cela entraîne une réduction remarquable de la pression interne de l'œil et donc une régression de l'exophtalmie, de sorte que la vision peut se rétablir. Les images diplopiques sont très rares avec cette méthode chirurgicale.